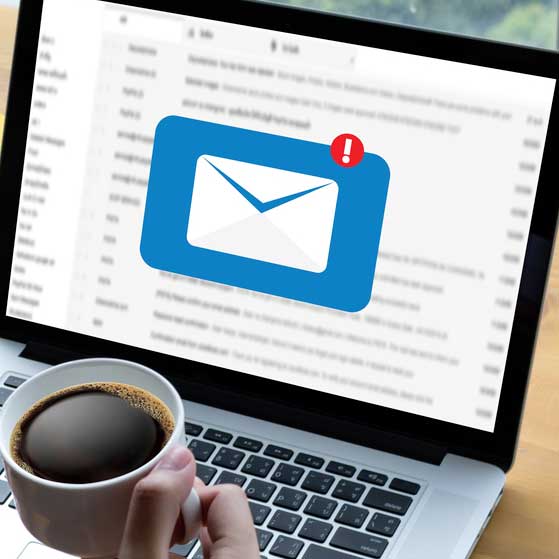Trois femmes poignardées dans le métro parisien. Un agresseur déjà condamné. Un individu sous obligation de quitter le territoire français (OQTF). Un passage par un centre de rétention administrative, puis une remise en liberté au terme des 90 jours légaux. Et, en amont, une décision du Conseil constitutionnel ayant censuré l’allongement de la durée de rétention à 210 jours, pourtant votée par le Parlement.
La mécanique est implacable, presque clinique. Elle illustre une fois de plus la domination d’un juridisme abstrait et mortifère.
Une décision prise à une voix près
Le détail n’est pas anodin. L’allongement de la rétention administrative a été censuré à une seule voix. Une voix qui, à elle seule, a fait basculer la balance du côté d’une lecture rigide des principes, au mépris des circonstances concrètes.
Le texte visait pourtant des profils bien identifiés : étrangers condamnés pour des faits graves, présentant un risque élevé de récidive, et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Rien d’arbitraire. Juste une tentative de colmater une faille béante du système.
Le Conseil constitutionnel, intouchable et irresponsable
Dans le débat public, toute critique du Conseil constitutionnel est immédiatement disqualifiée. Les « Sages » seraient au-dessus de tout soupçon, protégés par leur fonction et leur vocabulaire feutré. Pourtant, leurs décisions produisent des effets très concrets, parfois tragiques.
Ils censurent, puis disparaissent derrière le paravent du droit. Ils ne répondent jamais des conséquences. Ils ne rendent de comptes à personne. Le sang, lui, ne les éclabousse jamais.
L’idéologie déguisée en neutralité juridique
On nous parle d’État de droit, de principes supérieurs, de garanties fondamentales. Mais derrière cette rhétorique se cache souvent une idéologie parfaitement assumée : celle d’un monde théorique où le risque serait une abstraction et la violence une anomalie statistique.
Dans ce monde-là, la protection de la société passe après la protection des procédures. La sécurité des citoyens devient secondaire face à la pureté du raisonnement juridique.
Les victimes toujours absentes des raisonnements
Dans les attendus des décisions, il n’est jamais question des futures victimes. Jamais question de la femme qui prendra le métro un vendredi après-midi. Jamais question du corps qui tombera, du sang sur le quai, du traumatisme à vie.
Le droit raisonne hors-sol. Il anticipe des principes, jamais des conséquences. Il protège des concepts, jamais des personnes.
Gouverner sans jamais assumer
Le Parlement vote. Le gouvernement promet. Le Conseil constitutionnel tranche. Puis, lorsque le drame survient, chacun se renvoie la balle. Les ministres évoquent un « cadre contraint ». Les juges se retranchent derrière la Constitution.
Personne n’assume. Personne n’est responsable. Et pourtant, tout le monde savait.
Une fracture de plus entre le pays réel et ses institutions
À chaque fait divers de ce type, la fracture s’élargit. D’un côté, un pays réel qui voit, comprend, subit. De l’autre, des institutions qui raisonnent en circuit fermé, convaincues de leur supériorité morale et intellectuelle.
Ce décalage nourrit la colère, la défiance et le sentiment d’abandon, bien plus sûrement que n’importe quel discours politique.
Jusqu’à quand ?
Jusqu’à quand acceptera-t-on que des décisions prises dans le confort feutré des palais juridiques exposent les citoyens ordinaires à des risques parfaitement identifiés ?
Jusqu’à quand le droit servira-t-il d’alibi à l’inaction et à la lâcheté politique ?
Car à force de sanctuariser des principes déconnectés du réel, ce sont toujours les mêmes qui en paient le prix.