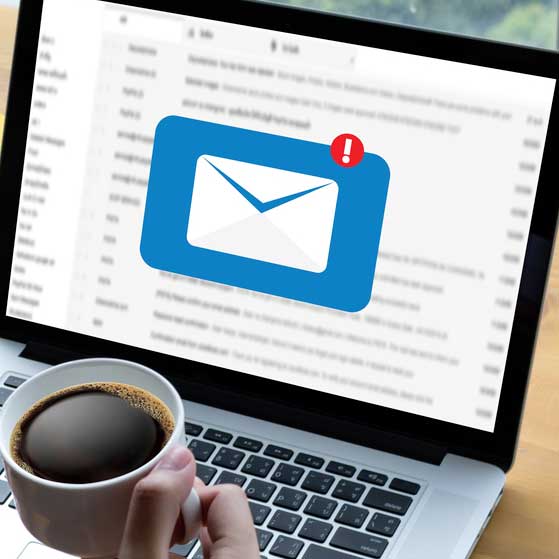Le débat politique et social qui agite la France dépasse la simple question budgétaire. Derrière la récente adoption sénatoriale d’une surprime d’assurance de 5 % destinée à couvrir les dégâts causés par les émeutes, c’est une crise de confiance profonde qui s’exprime. En prétendant soulager les assureurs — et donc les victimes — l’État révèle surtout son incapacité à assurer la sécurité fondamentale des citoyens.
Ce prélèvement, présenté comme un mécanisme d’indemnisation, ressemble moins à une solution qu’à une capitulation. En effet, plutôt que de restaurer l’ordre et de prévenir les débordements, nos institutions transforment les citoyens en banquiers involontaires d’un désordre qu’ils n’ont pas choisi.
Il faut bien mesurer l’ironie tragique de la situation : alors que l’on exige des mesures toujours plus coercitives pour taxer jusqu’à la moelle les contribuables ordinaires, on n’ose pas s’attaquer aux racines des violences urbaines. On préfère imposer une « prime émeutes » qui sera inévitablement répercutée sur les automobilistes du quotidien, les artisans, les commerçants et les familles déjà étranglées par les prélèvements.
Cette surprime, loin d’être une réponse pragmatique, envoie un message désastreux. Elle normalise les émeutes comme si elles étaient comparables à une catastrophe naturelle : un aléa climatique qu’on ne peut ni anticiper ni empêcher. Or, les orages, tempêtes et inondations ne résultent pas d’un choix humain, contrairement aux violences urbaines. En assimilant ces phénomènes à des catastrophes « naturelles », l’État renonce à sa mission première : garantir la sécurité.
Ce renoncement n’est pas neutre. Il légitime, tacitement, un climat d’insécurité croissante. À force de considérer les troubles comme inévitables et coûteux, on encourage leur répétition. Chaque fête populaire, rencontre sportive ou rassemblement festif devient désormais un terrain de chaos prévisible, presque attendu, et donc financièrement redistribué.
Pire encore, cette mesure dilue la responsabilité personnelle et collective des fauteurs de troubles. En les traitant comme un risque à mutualiser, on évacue la dimension morale des actes commis. Ceux qui détruisent, incendient, saccagent finissent par être intégrés dans un bouclier financier qui pèse sur tous. Ce n’est plus « tu casses, tu répares » : c’est « vous cassez, nous payons ».
La démocratie ne se résume pas à une comptabilité froide des coûts. Elle suppose une définition claire de ce qui est acceptable et de ce qui ne l’est pas. Elle réclame une autorité capable de protéger les citoyens, pas de les spolier pour compenser son propre échec.
Pour restaurer l’ordre, il ne suffit pas d’alourdir les factures des honnêtes gens. Il faut rétablir l’autorité, réinvestir dans la justice et la sécurité, soutenir ceux qui subissent les violences plutôt que ceux qui les perpétuent, et enfin reconnaître que la paix sociale ne se négocie pas au prix d’un chèque.
Ainsi, plus qu’une « taxe émeutes », ce nouvel impôt improvisé est le symbole d’une faillite : celle d’un État qui abandonne sa mission régalienne et préfère faire payer les Français pour compenser son impuissance.