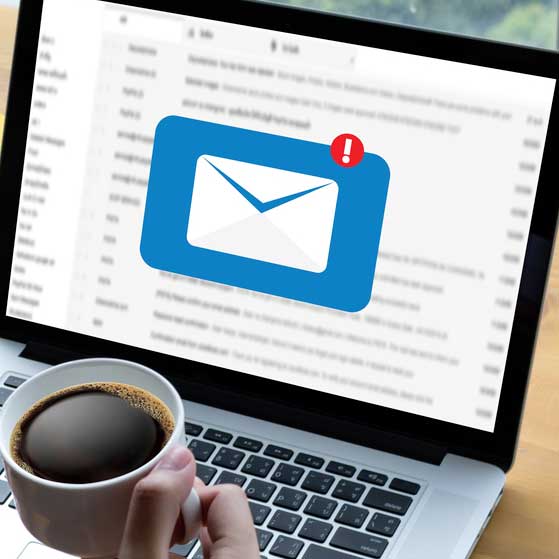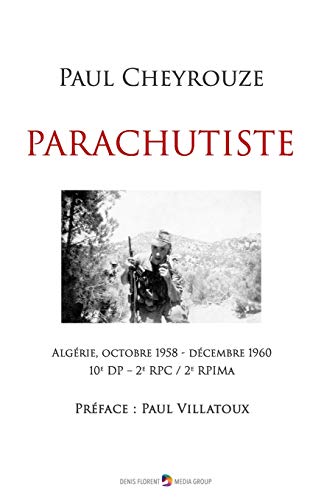Dans un paysage politique européen où beaucoup se contentent d’accompagner les mouvements d’opinion sans jamais oser dire ce qu’ils pensent réellement, la prise de position du Prince de Monaco surprend. Et, oseriez-vous le nier, elle rafraîchît presque. Albert II a choisi de ne pas « donner suite » à un texte législatif qui visait à légaliser l’avortement jusqu’à douze semaines, avec dérogation jusqu’à seize en cas de viol. On peut être d’accord ou non avec lui ; mais il faut reconnaître une chose simple : il assume. Et dans l’époque actuelle, cela devient rare.
Ce qui frappe, dans sa déclaration, n’est pas le ton péremptoire que certains lui prêteront. Non. C’est plutôt sa manière de replacer un débat brûlant dans ce qu’un souverain devrait toujours considérer : l’identité d’un pays, ses fondements, son équilibre. Là où beaucoup se contenteraient de répéter les mots d’ordre d’organisations militantes ou d’ONG exigeant la « mise à niveau » législative des derniers États récalcitrants, Albert II rappelle que Monaco n’est pas une annexe de quelque laboratoire normatif européen. La Principauté possède une histoire, une culture, un socle, et elle est en droit de ne pas marcher au pas forcé.
Il ne s’agit pas, contrairement à ce que certains caricatureront, de nier les drames, les situations douloureuses, les détresses. Le souverain, au contraire, a pris soin d’évoquer la sensibilité du sujet, les expériences traumatiques que certaines femmes peuvent connaître. Depuis 2009, Monaco reconnaît d’ailleurs des exceptions — viol, danger pour la mère, anomalies graves du fœtus — et depuis 2019, l’avortement n’y est plus pénalement réprimé. Bien des pays prétendument « modernes » n’ont pas su gérer des transitions aussi délicates avec autant de nuances.
Mais ce que le Prince refuse, c’est la fuite en avant législative qui transforme, année après année, des questions de conscience en simples cases à cocher dans un programme politique. Ce qu’il récuse, c’est l’idée qu’un État doit nécessairement se conformer à un modèle unique sous peine d’être étiqueté « arriéré », « rétrograde » ou, pour employer le vocabulaire militant, « hostile aux droits ». Dans sa décision, il y a une idée qui hérisse les technostructures : un peuple peut décider de rester fidèle à son identité sans pour autant devenir un paria moral.
On peut toujours objecter que les Monégasques peuvent franchir la frontière en quelques minutes. C’est vrai, et cela atténue sans doute une partie des tensions. Mais cela ne change rien à l’essentiel : un dirigeant, pour une fois, n’a pas choisi la facilité. Il n’a pas cherché la flatterie médiatique. Il n’a pas sacrifié la cohérence de son pays pour quelques applaudissements.
La décision d’Albert II rappellera à certains que l’Europe n’est pas un bloc uniforme où l’on doit tous penser et voter de la même manière. Elle montre qu’il existe encore des dirigeants capables de considérer qu’une nation — grande ou petite — n’est pas un simple terrain de jeu idéologique. Et surtout, elle rappelle que gouverner, ce n’est pas répéter ce que d’autres voudraient entendre, mais tenir debout, sans vaciller, lorsqu’un choix engage ce que l’on est.
Si cela dérange, c’est peut-être précisément pour cela que c’est salutaire.
L'actualité internationale et les enjeux géopolitiques ont une grande influence sur la vie des Français. Pour cette raison, le Journal des Français fournit à ses lecteurs une relation et une analyse des événements internationaux les plus importants.
Vous lisez cet article parce qu'il est d'accès entièrement gratuit, offert à tous les lecteurs. D'autres articles sont réservés à nos abonnés.
En choisissant de vous abonner, vous permettez à la presse non-subventionnée d'exister et de vous informer avec un regard libre sur les événements internationaux.
5€/mois — petits revenus
7€/mois
RecommandéAccès abonnés :
- ✓Lecture de tous nos contenus réservés aux abonnés
- ✓Possibilité de commenter tous nos articles
- ✓Gestion de votre abonnement en un clic