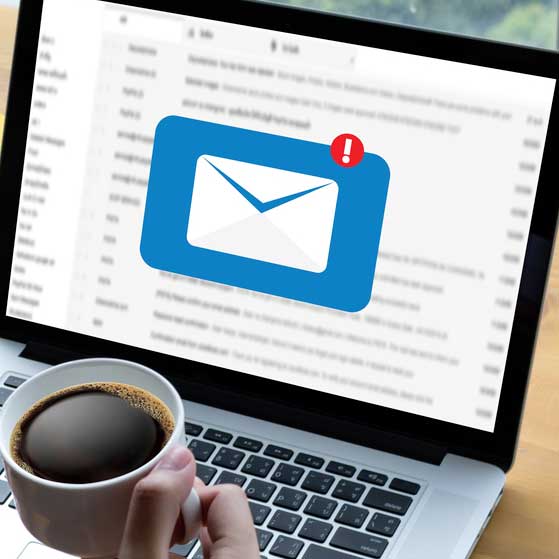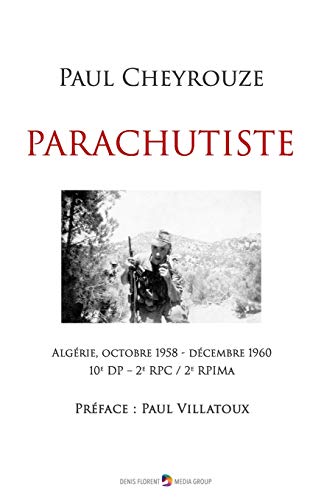La scène paraît irréelle, et pourtant elle se déroule dans la deuxième ville du pays : un géant des télécommunications ferme son site marseillais pour plusieurs semaines, faute de conditions minimales de sécurité autour d’une sortie de métro. Mille salariés priés de rester chez eux ou d’aller voir ailleurs, non pas pour cause de travaux, mais à cause d’une rue où l’on se bat pour un bout de trottoir.
On nous parle de « tensions ». Le mot est aimable. Les salariés, eux, ont été confinés parce qu’une bagarre entre trafiquants a éclaté sous leurs fenêtres. Ils mentionnent également une fusillade fin octobre. Quand des employés doivent se barricader le temps que les armes refroidissent, ce ne sont plus des « tensions », c’est un quartier qui bascule.
La direction explique attendre un « retour à une situation apaisée ». Quel apaisement, exactement ? Celui où l’on ne tire pas tous les jours ? La résignation administrative face à l’insécurité finit par devenir une absurdité tranquille. On en arrive à la situation cocasse où l’absence de douilles est utilisée pour relativiser des détonations entendues par tout le monde.
Dans la rue, la réalité ne prend pas de gants. Le narcotrafic use les habitants, terrorise des salariés qui n’ont rien demandé, et impose ses horaires. Et c’est une entreprise nationale, connue dans le monde entier, qui plie bagage temporairement pour ne pas exposer davantage ses équipes. Voilà où nous en sommes : ce n’est plus le commerce de quartier qui ferme sous la pression – ce qui était déjà insupportable -, mais un mastodonte doté de moyens considérables. Un site « emblématique », dit la CGT, qui voit dans cette fermeture un signal déplorable envoyé à ceux qui vivent là et qui, eux, n’ont pas le luxe de délocaliser leur domicile.
À Marseille, les homicides liés aux trafics rythment les semaines comme une météo sinistre. Cet automne encore, la ville entière a été bouleversée par la mort d’un jeune homme, frère d’un militant engagé contre les dealers. Faut-il vraiment s’étonner que des salariés finissent par travailler sous escorte policière, quand des habitants n’osent plus sortir pour acheter une baguette ?
On peut comprendre l’émotion, dit la préfecture. On aimerait surtout comprendre comment un quartier peut en arriver à un tel degré d’abandon que des entreprises finissent par se retirer pour attendre que les choses se calment. Le retrait est toujours un aveu : un territoire a glissé, une autorité s’est effacée, une population a été laissée seule.
La France répète qu’elle ne cède jamais. Pourtant, ici, elle recule d’un pas, en espérant que personne ne le remarque.
Mais un immeuble de mille salariés qui se vide du jour au lendemain, ça fait du bruit.
Même quand les coups de feu ne laissent aucune trace.